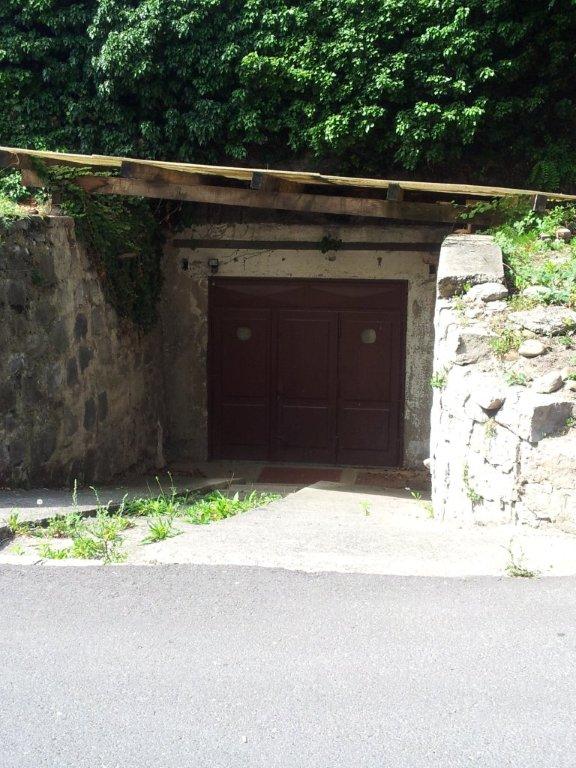ou La frustration d’un conteur qui préfère les histoires bien claires !

La localité de MURG au bord du Walensee.
On distingue la vallée frontière où coule le Murgbach www.quarten-tourismus.ch
Quoi de plus naturel que de se poser la question de l’origine du nom de sa ville ?
En ce qui concerne Morges, le premier élément est bien connu . Au XIIIe siècle, lorsqu’il fonda la ville près du château et du port, Louis de Savoie lui donna le nom de la rivière qui, à cet endroit, se jette dans le Léman.
Les historiens locaux ont longtemps peiné à trouver une signification et une origine à cette appellation « MORGES » jusqu’à ce que se généralise une explication que vous connaissez sans doute : le nom de notre rivière et de notre ville signifie « frontière, démarcation, limite ». Selon des étymologistes, il est issu de la racine celtique morg, elle-même descendant d’une racine indo-européenne. A travers le latin et le haut allemand, Morges est parent avec « marge » ou « marche » soit région frontière. [Henry Suter, «Glossaire des toponymes»]1
L’équivalent alémanique de Morges est Murg. (Les experts sont d’accord sur ce point).
Cette explication a l’avantage de nous inviter à un petit voyage à travers la Suisse pour constater qu’apparemment tous les éléments s’emboîtent parfaitement :
Murg est souvent le nom d’une rivière qui, comme notre Morges, a donné son nom à une localité, par exemple à Murgenthal. En aval du couvent de St. Urban (à l’est de Langenthal), la Murg se jette dans l’Aar. Or, que constatons- nous ? Cette rivière marque la frontière entre les cantons d’Argovie et de Berne. Historiquement, cette limite est antérieure à la constitution du canton d’Argovie (1803). La Murg était déjà la frontière entre l’Etat bernois et les bailliages conquis au XVe siècle. En amont, la même rivière (mais sous un autre nom) sert de frontière entre Berne et Lucerne.
Plus à l’est de la Suisse, une autre rivière porte le même nom. Née dans un lac à 1800 mètres d’altitude, la Murg saint-galloise, (plus exactement Murgbach) dévale des montagnes glaronnaises pour se jeter dans le lac de Walenstadt. Sur le delta qu’elle a formé se trouve la localité de Murg. Située face à la paroi majestueuse des Churfirsten et à la célèbre localité vigneronne de Quinten (probablement le seul village suisse de plaine inaccessible par la route. Pour s’y rendre il faut ou bien marcher ou prendre le bateau depuis Murg). Cette dernière est une plaisante localité industrielle et de séjour au bord du lac. Comme il fallait s’y attendre, Murg est depuis des siècles une frontière, celle qui délimite Glaris et St. Gall.
Encore une rivière homonyme : la Murg de Thurgovie prend sa source dans les Préalpes, court plein nord pour se jeter dans la Thur à Frauenfeld. En amont du couvent de Fischingen, sur une brève portion de son parcours, elle sert de frontière entre Thurgovie et St. Gall. Là, un hameau porte son nom.
Passons à la Suisse romande et à la Morge(s).
Peu avant Sion, en suivant la route cantonale, on traverse la localité de Pont de la Morge où l’on franchit cette Morge, torrent dégringolant du Sanetsch qui, là, rejoint la plaine après avoir franchi d’impressionnantes gorges surmontées du Pont du Diable. Point-là de frontière cantonale actuelle certes, mais un coup d’oeil à l’histoire du Valais nous apprend qu’à la suite de la conquête savoyarde du Bas-Valais (1260), la Morge devint la frontière entre la Savoie et le Valais épiscopal.
A l’autre bout du canton, une autre Morge déboule de la Dent d’Oche pour se jeter dans le Léman au centre du village de St-Gingolph. Ici, la frontière est bien visible, puisque le pont est bordé des deux douanes française et suisse. Au long de son cours, cette rivière constitue la frontière nationale. Elle découpe la petite localité en deux communes : St-Gingolph Suisse et St-Gingolph France qui n’en forment pas moins une seule paroisse. L’origine de cette limite est claire : suite aux guerres et conquêtes des Bernois et des Valaisans dans le Chablais savoyard, on signa le traité de Thonon (le 4 mars 1569) qui fixait sur la Morge de St-Gingolph la nouvelle frontière entre le Valais et la Savoie. En 1860, l’annexion de la Savoie par la France ne changea rien et tout naturellement la Morge devint frontière franco-suisse.
On pourrait citer encore l’exemple de Morgins où passe la même frontière (mais sans rivière).
Alors à Morges, quelle frontière ?
Personne n’a jamais vu de douane sur le pont au débouché de la Place Dufour ! On a beau gratter l’histoire, on échoue à découvrir une période où notre « fleuve local » aurait marqué la limite entre deux territoires distincts. Du temps des Bernois, certainement pas. Auparavant, Louis de Savoie avait bien enfoncé un coin savoyard dans les possessions de l’évêque de Lausanne, mais sans que la rivière constitue une limite. Et même au temps précédent de la féodalité, les différents seigneurs dans leur compétition avec l’évêque ne semblent pas avoir placé là une démarcation. L’Encyclopédie Vaudoise décrivant la situation du début du XIIIe parle de « la jungle qu’était alors le diocèse de Lausanne et le Pays de Vaud » ! Par contre, on est bien renseigné sur le rôle de frontière que jouèrent longtemps les deux principales rivières voisines : l’Aubonne fut durant des siècles la borne occidentale du diocèse de Lausanne. Au-delà l’évêque de Genève exerçait sa juridiction. De même la Venoge délimita la possession savoyarde de la terre épiscopale de Lausanne. Par la suite, notre « fleuve vaudois » a continué de jouer le rôle de limite administrative.

En observant attentivement cette vue de Saint-Gingolph on repère le cours de la Morge qui partage le village et fait frontière entre le Suisse et la France.
Notre belle explication du lien entre une rivière portant le nom de Morge et une fonction frontière qui serait à l’origine de l’appellation trouve là, pour le moins, une exception. D’autres éléments ne tarderont pas à la faire voler en éclats. En effet, des étymologistes de la toponymie ont proposé plus récemment une nouvelle origine qui serait moins hypothétique : le toponyme Morges serait dérivé d’une base indoeuropéenne (mer[e]g) signifiant « marais, rivière marécageuse ». Foin de toute référence à une limite ! D’ailleurs ces mêmes chercheurs ont regardé les détails et rapporté des observations qui tordent le cou à notre belle construction : Ces différentes rivières nommées «Morge/Murg» font bien fonction de frontière, mais elles ont reçu leur nom bien antérieurement à l’établissement de la démarcation politique qu’on leur confie ! Par ailleurs, certains cas cités plus haut sont problématiques : a Murgenthal, la rivière homonyme est très courte par rapport à une frontière qui suit longuement le cours d’eau, mais qui se nomme autrement ! A y regarder de plus près, à Murg (St. Gall) l’historique frontière entre les deux cantons de Glaris et St. Gall ne court pas précisément le long de la rivière, mais sur la crête de montagne qui la surplombe, etc.
Il faut s’y résoudre, notre belle explication nous a peut-être procuré un agréable voyage à travers la Suisse, mais elle tombe finalement dans le marécage !
(Si cela vous tente, vous pouvez poursuivre la recherche : des «Morge / Murg» coulent aussi en Allemagne, en Val d’Aoste et en France.)
Jacques Longchamp
Illustrations
1 Extrait de «NOMS DE LIEUX DE SUISSE ROMANDE, SAVOIE ET ENVIRONS de Henry Suter.
http://henrysuter.ch/glossaires/patois.html